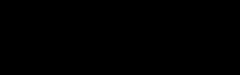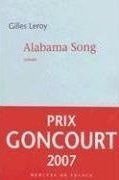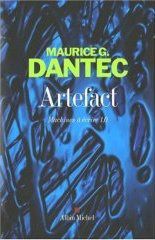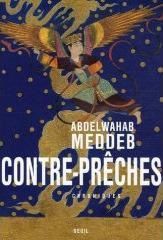Le 19 juin 2008, les éditions J’ai Lu fêteront leur cinquante ans. Voilà une belle occasion de célébrer et d’affirmer la singularité du catalogue poche de Flammarion. Depuis toujours, J’ai Lu se targue d’être la plus féminine des maisons d’édition. Qu’à cela ne tienne ! Après 10 auteurs, 10 nouvelles qui fêtaient les 10 ans de la collection « Nouvelle génération », la publication anniversaire se la joue 100% femme avec le recueil Onze femmes, onze nouvelles inédites dont les écrits s’articulent autour de l’identité féminine.
Elles sont onze. Onze femmes d’âges, de sensibilités et d’origines différentes. Onze plumes surtout. Femmes avant tout, épouses, mères ou femmes d’affaires, elles sont journalistes - en presse écrite ou en télé – écrivaines, éditrices ou portent toutes les casquettes à la fois… globe trotter traductrice, musicienne ou encore comédienne, onze femmes s’attaquent avec leurs armes au thème, certes classique mais fatalement insaisissable, de l’identité féminine, et plus précisément de la place du corps dans la féminité. « Etre une femme aujourd’hui, est-ce seulement avoir un corps de femme ? », leur a-t-on demandé. Aux auteurs ensuite de plancher sur la question, et de livrer une nouvelle. Au final apparaissent onze regards hétéroclites et tranchés. Ici rien d’uniformisé, de cadré, de lissé. Cette diversité de points de vue, de récits et de perceptions de la femme fait la force de ce recueil, dans lequel les écrivains ont su s’affranchir de l’aspect complexe du sujet initial pour ne conserver que l’essence de la féminité. Ou plutôt d’une certaine féminité.
« On ne naît pas femme, on le devient. » avait écrit de Beauvoir dans son Deuxième sexe en 1949. Réplique usée à force d’être citée, elle n’en reste pas moins d’actualité, et quelque soit l’époque. Mais qu’est-ce donc que « devenir » femme ? Tel est le débat, ou l’énigme. Être femme, n’est-ce qu’une affaire d’attributs sexuels identifiables, dont l’apparition affirme « l’état » de femme ? N’est-ce qu’une « notion » régie, codée par la biologie, la société, l’histoire, la politique ou le regard des hommes, comme l’affirmait le féminisme classique ? Ou bien est-ce une relation intime, un rapport à soi et à son corps, comme tendent à le confirmer les dernières enquêtes sociologiques d’Alain Touraine ? S’agit-il d’une identité qui se construit à travers le regard d’autrui, et de l’homme en particulier ? Est-ce un apprentissage, une appropriation, un assujettissement ou une simple acceptation d’un fait inné ? De Badinter à Fraser en passant par Fouque, les théories ne manquent pas. Que l’on soit d’accord avec les unes ou avec les autres, il semblerait que l’identité profonde de la femme ne se dessine que par touches, versatiles, éphémères et sans cesse démenties par une autre conception : conception d’un autre temps, d’une autre discipline ou d’une autre… femme ! Il semblerait que cette identité se dessine par des expériences vécues ou retranscrites, précisant sans cesse de nouvelles zones d’ombre. Face à cet imbroglio, Onze femmes, onze nouvelles inédites répond avec la même complexité, multiplicité des approches oblige : les auteurs sont toutes des femmes, et elles ne le vivent pas ou ne le conçoivent pas de la même manière. Pas de panique cependant, l’éventail des propositions et des nuances n’a rien d’un assemblage brouillon des théories des figures féministes ! Sans vouloir faire entrer la féminité dans des cases étriquées ni dans une définition figée, toutes ces nouvelles racontent la femme, les femmes.
A une question dense et subtile, potentiellement pesante, nos onze auteurs répondent par des portraits de femmes attachantes, fragiles ou déterminées, nous plongeant instantanément dans onze univers singuliers, onze styles aussi. Les visages prennent corps et les corps s’évaporent quelquefois d’avoir été trop exposés. Les onze personnages centraux s’avèrent terriblement humains, dans leurs forces comme dans leurs failles et autres attentes, espoirs ou rôles. Pas question dans ces récits de philosophie ou de morale, pas de discours normatifs sur ce qu’est ou ce que devrait être une femme. Simplement des regards de femmes sur des femmes. Aucune des onze figures n’est plus pertinente qu’une autre ; elles sont toutes, à leur manière, la plus authentique.
Pas d’ennui à l’horizon dans ce recueil dans lequel aucune histoire ne ressemble à une autre. Pourtant il y a bien des aspects que ces nouvelles partagent : les protagonistes sont évidemment toutes des femmes et sont toujours liées à un autre personnage, souvent un homme, son regard ou son fantôme. Chaque écrivain a pris ses aises, en appelant à l’amour, à l’envie, à la jalousie, au plaisir, à la mort, à la filiation mais aussi à la violence, au manque, à la peur, au désenchantement, à l’abandon ou à l’oubli... Les nouvelles sont tour à tour impudiques, poétiques ou dérangeantes. Certaines sont pleines d’humour ou de tendresse, d’autres crues parfois mais toujours touchantes. Que les héroïnes se révèlent fragiles, drôles ou sûres d’elles, manipulatrices, légères, perdues ou frondeuses, il transparaît toujours en filigrane une quête d’elles-mêmes, malgré les airs qu’elles se donnent de ne pas s’en préoccuper.
Autre similitude : pour parler de la femme – comme de n’importe quoi d’autre ! - il faut la confronter à quelqu’un, à un regard, à un autre. Chez Yasmina Jaafar, Jessica Nelson et Stéphanie Polack il s’agit de mettre une femme face à un homme ; Audrey Diwan et Camille de Peretti mettent deux femmes face à face ; Brigitte Giraud confronte une petite fille à un petit garçon tandis que Catherine Castro, Olivia Elkaim et Anna Rozen placent simplement une femme face à la société. Enfin Anne Plantagenet et Tania de Montaigne choisissent de faire pencher leur femme sur le corps d’une autre, absente ou morte. Alors nos héroïnes sont observatrices, nos narratrices font de la comparaison et de l’opposition l’étalon d’une couleur féminine, car il faut bien figer un instant la féminité, à travers le corps ou pas. Chacun des deux personnages d’un duo révèle l’autre, et de ces couples unis ou désaccordés ressort donc une image de la femme : c’est dans la relation au monde, aux autres, hommes ou femmes, inconnus et proches, que naissent les contours, certes flous, des individualités féminines. Mais n’est-ce pas ainsi que sont nées toutes les définitions humaines, du temps de Platon, de Rabelais ou de Weber ? Autrement dit les femmes se trouvent ou se cherchent comme n’importe quel homme de l’Histoire : l’homme se révélait animal politique dans sa rencontre avec la cité, il se révélait sujet dans sa rencontre avec la société, voilà maintenant la femme dans ce mouvement réflexif. Son identité prend ses contours à travers tout ce qu’elle combine : une femme est face à tous les autres, avec elle-même et dans une société. Et si nos femmes se racontent, la trame narrative n’exclut en rien l’intrusion dans ces couples de spectres du passé, des souvenirs d’un amant ou d’une mère, d’une sœur, d’une blessure ou d’un désir d’exister, de prendre corps et sens...
Mentions spéciales pour le texte d’Anna Rozen qui ne manque pas d’humour ni de fraîcheur ; pour la nouvelle de Jessica L. Nelson dont le choix narratif célèbre les contradictions de son héroïne ; enfin pour la chute de Catherine Castro, qui revient dans son texte sur les dictats d’une société qui a une dent contre le corps des femmes.
Extraits choisis…
« Mon corps m’encombre, j’ai décidé de le vendre sur e-bay. Finalement, un corps qu’on trimballe depuis trop d’années c’est comme les livres qu’on a déjà lus, les vêtements qu’on a plus envie de porter, les DVD qu’on a assez regardés, les CD qu’on connaît par cœur et tout ce fatras qui prend beaucoup de place pour pas grand-chose. » Anna Rozen.
« Cher Monsieur, je ne suis pas une fille facile : mon cœur a la profondeur d’un puits dans lequel je trébuche souvent, ce qui ne m’empêche pas d’y replonger avec délectation lorsque mes vêtements sont à nouveau secs. Je n’ai pas l’intention de m’en défendre, tout ce qui suit et qui choquera, autant vous prévenir que je l’assume ». Jessica L. Nelson.
« Tout ce que je sais de Lola, c’est qu’elle danse seule devant sa glace. Elle aime se regarder danser, même si ce n’est pas parfait. Ca ne le sera jamais. L’appartement est propre et bien rangé. Avec de gros coussins dorés sur le canapé et des napperons en dentelle sous les porcelaines du buffet. La glace est grande, Lola sourit et virevolte, ondule. Tout ce que je sais de Lola, elle ne me l’a pas dit, je l’ai deviné. ». Camille de Peretti.
A noter…
11 nouvelles inédites
Catherine Castro, Audrey Diwan, Olivia Elkaim, Brigitte Giraud, Yasmina Jaafar, Tania de Montaigne, Jessica L. Nelson, Camille de Peretti, Stéphanie Polack, Anne Plantagenet, Anna Rozen.
En librairie le 16 mai 2008
Aux éditions J’ai Lu
192 pages
10 euros
Deux particularités : le format poche a ici été revu à la hausse : 14,4 cm x 18,1cm et le recueil comporte un double portrait des auteurs réalisé par Olivier Roller. Un regard masculin sur l’identité corporelle féminine.
A lire aussi sur CultureCie...