
 Tirées de sa série "jamais 203", les peintures encore récentes de Patrice Palacio se jouent des genres en même temps qu'elles réfléchissent l'espace et le temps. Temps continu, temps arrêté, on est avec lui hors du champ de l'art contemporain que l'on a envie d'appeler "traditionnel". Hors champ et pourtant, les plans n'en finissent pas de se succéder, sans se suivre... Un coup de foudre esthétique et intellectuel est rare, il méritait donc une rencontre. Interview avec un acrobate de la mise en lumière.
Tirées de sa série "jamais 203", les peintures encore récentes de Patrice Palacio se jouent des genres en même temps qu'elles réfléchissent l'espace et le temps. Temps continu, temps arrêté, on est avec lui hors du champ de l'art contemporain que l'on a envie d'appeler "traditionnel". Hors champ et pourtant, les plans n'en finissent pas de se succéder, sans se suivre... Un coup de foudre esthétique et intellectuel est rare, il méritait donc une rencontre. Interview avec un acrobate de la mise en lumière. Les textes « dans la marge » ?
Pouvez-vous nous raconter l’histoire du texte avec lequel s’ouvre l’exposition ? L’avez-vous écrit après avoir réalisé vos tableaux ? Avant ?
Ce texte est le mien. Je l’ai pensé (et non écrit) avant les tableaux. En tous cas pour la moitié : l’autre moitié n’a pas encore été couchée. Les visuels, l’image du tableau, me viennent au fur et à mesure de ma vie et de mes rencontres. J’ai globalement en tête l’ensemble des sujets que je veux aborder visuellement et j’attends simplement qu’ils soient donnés à mes yeux pour les saisir. J’ai juste à attendre et tout m’est donné. C’est facile. Il en est de même pour le contenu du dialogue qui me vient naturellement, comme un fruit.
Pourquoi avoir choisi d’inscrire des textes « au hasard » dans chacun des tableaux ? Pour éveiller la curiosité du spectateur ? Pour le forcer à s’interroger sur ses réflexes : on est attiré par le texte comme par un sous-titre et… ces sous-titres m’ont semblé nous renvoyer nos réflexes en miroir, comme lorsque nous lisons des sous-titres d’un film dont on comprend la langue ?
Ce n’est pas pour éveiller la curiosité du spectateur, c’est plutôt, en effet, pour le forcer à s’interroger sur ses réflexes. Si le texte ne parle pas vraiment de l’image, il n’y a pas non plus vraiment de hasard, juste des rencontres, des juxtapositions entre le dialogue et le cours des visuels, qui me sont donnés à un moment précis. La peinture n’est pas pour moi une fin en soi. Elle contribue simplement à véhiculer une oeuvre plus grande, plus profonde, plus complexe. Au lieu de la renforcer, ces mots enlèvent quelques attributs à la peinture (l’ut pictura poesis), ils la ramènent vers l’objet, vers une certaine matérialité, un support. Et paradoxalement, redonnent à la peinture son sens premier, essentiel.

 Le miroir est la clé de voûte de cet édifice mental. Pour moi, le temps et l’espace sont miroir et reflet l’un de l’autre : il n’y a pas d’antériorité ou de supériorité de l’un sur l’autre, ils n’existent que par leur mutuelle dépendance, au point qu’ils ne pourraient ne former qu’un mais « s’installent » que par ce jeu du miroir, infiniment reflet et objet, tour à tour. Cette « image » du miroir est un recours artificiel à la sensation de réflexion. Je ne crée rien fondamentalement, tout est déjà là (cf « All is already done »), je ne fais que présenter, d’où l’emploi de photos que je ne modifie jamais, elles sont mes contraintes. Le miroir est une manifestation très abordable du temps.
Le miroir est la clé de voûte de cet édifice mental. Pour moi, le temps et l’espace sont miroir et reflet l’un de l’autre : il n’y a pas d’antériorité ou de supériorité de l’un sur l’autre, ils n’existent que par leur mutuelle dépendance, au point qu’ils ne pourraient ne former qu’un mais « s’installent » que par ce jeu du miroir, infiniment reflet et objet, tour à tour. Cette « image » du miroir est un recours artificiel à la sensation de réflexion. Je ne crée rien fondamentalement, tout est déjà là (cf « All is already done »), je ne fais que présenter, d’où l’emploi de photos que je ne modifie jamais, elles sont mes contraintes. Le miroir est une manifestation très abordable du temps. Ces mots et ces peintures évoquent une sorte de puzzle : on retrouve des phrases du texte dans les tableaux, puis on retrouve dans les tableaux des références à d’autres supports, on a l’impression d’un méta-langage : le texte parlerait des tableaux qui parlent, eux, d’autres artistes, d’autres moyens d’expression artistiques… Et pourtant les textes ne parlent pas vraiment des images : ils parlent de la mémoire ! D’une rencontre… avec un souvenir ? Ces multiples puzzles sont-ils une métaphore de la mémoire ?
Oui, en quelque sorte. Les 203 tableaux forment un dialogue qui traite de différents blocs qui n’ont pas de lien évident entre eux. Ce sont des blocs autonomes reliés par des passerelles : les images. En fait de « méta langage », il s’agit d’une « méta-structure ». C’est mon lien avec l’architecture :
L’espace / temps La vie / la mort L’amour Le rapport à soi / au monde La création Et oui, il s’agit d’une métaphore de la mémoire, un fond commun, un savoir disponible, une grande Mémoire. La notion de « phénomène » - mise en lumière – est sous-jacente.
Espace-temps
 Vous parlez beaucoup de vos toiles comme d’un travail sur l’espace et le temps, ou encore comme d’un travail sur l’histoire de l’art, mais vous parlez peu de mélancolie… pourtant la « fin » est omniprésente dans ce travail, non ?
Vous parlez beaucoup de vos toiles comme d’un travail sur l’espace et le temps, ou encore comme d’un travail sur l’histoire de l’art, mais vous parlez peu de mélancolie… pourtant la « fin » est omniprésente dans ce travail, non ? Pour moi, bizarrement, il n’y a pas de fin, ni de début. Evidemment pour l’Homme, il y a une chronologie, une chaîne logique cause/conséquence, une finitude. Mais mon sentiment, ma conviction est qu’il n’y a que des modifications, des transformations. Lavoisier le disait et le démontrait amplement. Le rapport « à la fin » dont vous parlez est simplement le reflet de ce que vous ressentez au travers de mes tableaux. Vous êtes peut être nostalgique avant mes tableaux. Mais la nostalgie est un sentiment qui, dans tous les cas, m’intéresse, que je trouve positif dans son côté méditatif. Sans finitude, vous auriez probablement une autre lecture de ce travail.
Ce qui est sûr, c’est que nous vivons une fin, à chaque instant du reste... Notre rapport au monde a changé. C’est pour cela que j’utilise la juxtaposition : les images mentales en noir et blanc sont juxtaposées à la couleur (la Nature). Elles ne se superposent quasiment jamais, sauf pour « Close to water... », qui est une prise de conscience dans le dialogue.
En quoi notre rapport au monde a-t-il changé ? Nous vivons de plus en plus à côté du Monde, en parallèle. Mais j’espère profondément que ce « mélange » entre la nature et nous reviendra.
La fin est la fin de certaines valeurs pour des nouvelles, lesquelles vous me direz : il suffit d’ouvrir les yeux et de discuter avec d’autres pour voir que nous vivons une transition des valeurs, des mœurs, des croyances, de l’intellect, du rapport à la vie, à l’autre. La vitesse, la rentabilité, l’expansion, le délitement, la crise de la réflexion etc. font partie du monde d’aujourd’hui. Mais c’est aussi un monde plein d’espoir.
Dans l’art, il y a un terme nouveau qui est intéressant : « l’art opportuniste ». Il y en a plein en ce moment dû, entre autres, à la mondialisation. D’ailleurs, si mon expo est bien accueillie par les critiques et les « penseurs », elle est confrontée à un « décalage » avec ce que les collectionneurs attendent aujourd’hui d’un tableau. Ce qui est bon signe, c’est que beaucoup s’accordent à dire que c’est nouveau dans cette approche de la peinture, une sorte de « méta peinture » mais c’est difficile, apparemment, à faire digérer : il faudra du temps, cela en a toujours été ainsi.
J’ai eu cette sensation que votre série parlait d’art comme elle parlait d’amour… C’est ça, le temps et la vie pour vous : l’art et l’amour, avec en filigrane la « fin » - celle du succès, celle de l’histoire, celle… de la vie ?
L’Art c’est de l’Amour, et la Vie c’est bien. Sens & ambivalences des références
Vous avez l’air de porter un regard ironique sur la reprise et les clins d’œil omniprésents dans l’art contemporain, pourtant vous dites que chacun de vos tableaux est une référence, et en effet on retrouve des références à tous les supports et à quelques images populaires : est-ce une manière pour vous de rendre hommage à vos « images cultes », à vos artistes favoris ?
 On ne peut échapper à la référence, d’ailleurs ce n’est pas ma volonté. En fait, je n’ai pas vraiment d’artiste favori, plutôt du respect pour des oeuvres intelligentes et intelligibles. Je ne souhaite pas m’opposer ou me mettre en concurrence à un quelconque mouvement ou une quelconque démarche. Je suis dans une optique de la réconciliation. La guerre est finie. Je suis inspiré par tout ce que je connais. Ma palette, c’est l’histoire de l’Art.
On ne peut échapper à la référence, d’ailleurs ce n’est pas ma volonté. En fait, je n’ai pas vraiment d’artiste favori, plutôt du respect pour des oeuvres intelligentes et intelligibles. Je ne souhaite pas m’opposer ou me mettre en concurrence à un quelconque mouvement ou une quelconque démarche. Je suis dans une optique de la réconciliation. La guerre est finie. Je suis inspiré par tout ce que je connais. Ma palette, c’est l’histoire de l’Art. A quoi fait référence, par exemple, « a place I knew » ?
L’univers cinématographique, comme Lynch. Psychologiquement, le foyer, la maison, l’attache physique. Il est important dans la série et revient régulièrement sous différents angles.
Et « A looking glass » ?
« Looking glass » est le terme utilisé par Lewis Caroll pour désigner un miroir dans Alice. Ici, c’est un peu le miroir brisé des apparences. Le tableau est la réponse aux questions : comment est le temps ? Comme de l’eau. Un miroir ? Le regardant, tu ne le vois pas...
La référence plastique est pop, les peintures poudre de diamants de Warhol par exemple, mais le verre provient de carcasses de voitures accidentées, rien de très sexy ni clinquant... Dans « A looking glass », on a l’impression que vous avez ramassé les restes de l’accident : du verre, des galets, du sable… ?
C’est vrai, j’ai dû tamiser et retirer les cheveux !
 Les natures mortes en noir & blanc évoquent la photo en même temps que des objets de représentation très classiques, que dire sur ce jeu du médium et de la chose représentée ?
Les natures mortes en noir & blanc évoquent la photo en même temps que des objets de représentation très classiques, que dire sur ce jeu du médium et de la chose représentée ? Pour moi, le noir et blanc, c’est l’image mentale de l’Humain avec une légère mise à distance, l’étiolement. Et puis j’ai une grande affinité avec le noir et blanc, j’éprouve un plaisir simple avec la nuance, le contraste, il n’y a pas d’artifice… là c’est le peintre qui parle !
Il m’a semblé que ces références ne se limitaient pas à la peinture, mais jouaient aussi avec le cinéma ou même les séries TV, pourquoi choisir de jouer avec ce mélange de genres ? C’est une manière pour vous d’installer la peinture dans un art plus contemporain qu’à son habitude ? Et de mêler cet art « noble » à des références très populaires, comme le roman photo ?
Oui, fortement pour le roman photo. J’utilise la peinture comme un véhicule. Je considère que les problématiques de noblesse, de genre, de contemporanéité sont d’un autre temps.
Est-ce qu’il y a une recherche sur l’essence de l’art dans votre travail ?
Oui, mais pas simplement l’Art. Si cela se limitait à l’Art, ce ne serait pas essentiel. L’Art est un véhicule.
C’est une recherche sur l’essence de quel concept ou substance, si ce n’est pas simplement l’art ?
L’essence est indicible. J’essaie de trouver des stratagèmes (la série, la peinture, le dialogue) pour la délimiter. En parler est pour moi difficile : regardez mes tableaux, et voyez le texte, c’est écrit blanc sur noir !
L’art « pur » réinventerait-il le medium comme la chose représentée ?
C’est la chose représentée qui questionne le médium.
Emotion & tout ordonné : ambivalence des sens
On a l’impression que vous jouez avec la culture, que vous vous amusez avec elle, que vous vous en moquez aussi… que doit-on déceler derrière cette ironie : la peinture parle d’elle-même et il est inutile d’avoir une culture quelconque pour la déchiffrer ? Ou au contraire, comme toute production « culturelle », elle demande une exigence, un savoir ? Mais l’essentiel, en art, reste l’émotion… non ?
La culture est fondamentale mais la dépasser est essentiel. Tout n’est qu’outil. Il faut savoir aimer, contempler, s’autoriser le bonheur simple.
Vos séries font référence à tous les supports, et pourtant il en ressort un tout très ordonné, une totalité très cohérente, personnelle, sans dispersion, presque rectiligne… Il semble que votre travail soit très réfléchi. Comment avez-vous procédé ?
Ce protocole de travail est en effet très pensé, très dosé. C’est une architecture complexe qui, comme en musique, établit des rythmes, des dissonances, des harmoniques par la monochromie ou la couleur, le matériau, les silences... Tout a été pensé au départ, les visuels me sont donnés au fur et à mesure, je n’ai qu’à attendre.
De prime abord, un chaos, une dispersion m’a souvent été reprochée car il est difficile pour le spectateur de cerner le « système », comme par exemple pour l’une de mes galéristes, qui a eu beaucoup de mal avec le texte : elle ne voyait pas pourquoi ces « belles peintures » étaient dé-figurées. A force, elle a compris la nouveauté d’approche.
La mémoire & ses mystères
Vous dites qu’il n’y a pas de début ni de fin dans vos séries, mais on a tout de même l’impression que vous racontez une histoire avec cette série. Ce serait quelle histoire ? L’histoire de la mémoire ?
 Oui. Fragmentaire, oubliée, confuse ? Oui.
Oui. Fragmentaire, oubliée, confuse ? Oui. La mémoire d’un homme, la mémoire d’une culture ?
Oui. « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens », dites-vous : vous ne savez pas où vous allez ?
D'après vous ? Ou vous vous adressez à une génération qui ne sait pas où elle va ?
L’avenir le dira ! La scénographie est-elle une manière de faire vivre cette expérience de la mémoire au spectateur, dans un temps et un espace réduits ?
La scénographie n’est pas de mon fait. Je propose une série où chaque tableau a un suivant et un précédent. Mon but est, un jour, de voir exposer ces 203 tableaux qui forment un tout. Ce sera difficile mais je travaille dans cet objectif. Ce sera une autre oeuvre. Une méta oeuvre. En cela, j’ai une préoccupation de vidéaste.
En plaçant le texte entier au début de la visite, tout se passe comme si le sens était à trouver au début et non à la fin… pourtant ce texte n’est pas ce qui donne sens à vos peintures…
Le texte au début a été placé pour simplifier la visite au spectateur, il n’est pas obligatoire de lire cet extrait (car il n’est pas complet) pour apprécier, ou non, le travail présenté.
Vous jouez des tours à vos spectateurs comme l’art vous joue des tours ? Comme la mémoire vous joue des tours ?
Je ne m’en souviens plus. Peintures & sculptures
J’ai lu que chaque image était l’une de vos créations, il n’y a aucun collage ?
En effet, chaque image est de moi, il n’y a aucun collage, que de la peinture, mais j’utilise d’autre matériaux, tout ce qui peut servir mon idée : du verre, du linoléum, du fil de laine, du plexiglas, des bonbons, de la limaille de fer...
Vous avez commencé à sculpter : on retrouve là encore des références au Pop Art, mais vos sculptures donnent l’impression que vous épurez ce mouvement, que vous éliminez ses fioritures… C’est voulu ?
Totalement. J’aime beaucoup le pop, il a été très utile. Je prends le contre-pied du pop : prendre des codes populaires de masse et les rendre individuels.
Par exemple, 1 kilo d’espoir en porcelaine : chacun est tourné et façonné à la main (y compris les lettres de "1 kilo d'espoir") mais tous semblent quasi identiques.
Que voulez-vous dire ?
L'idée est de les faire les plus ressemblantes possibles, de donner l'impression d'une fabrication de masse (la boite de conserve) mais en réalité elles sont toutes uniques. Quand on observe de plus près, il n' y a pas de "masse", c'est mon espoir. D'où le rapport poids (1 kilo) et masse (production de masse, la boîte de conserve). Et donc la pièce représente 1 kilo d'espoir : espoir que la vie, le monde ne soit pas uniforme, au delà des apparences.
Vous « Le déroulement de ce travail interroge la relation entre vie quotidienne de l’artiste en tant qu’individu et l’influence de l’art sur cette existence. L’art vient il de l’artiste ou de l’individu ? Et finalement qui subit l’autre ? » demandez-vous. Vous avez l’impression de subir l’art ?
 Oui, comme une tâche à accomplir, un métier.
Oui, comme une tâche à accomplir, un métier. J’ai lu que vous vous étiez orienté très tôt vers un parcours artistique…
Oui, très tôt : mes premières peintures ont été faites vers l’âge de 6 ans. J’ai toujours peint et dessiné. J’ai décidé d’en faire mon métier vers 20 ans, par envie et par plaisir, et un peu par nécessité intérieure
Quelles ont été vos premières amours artistiques, vos premières initiations ?
Mozart, Canova, Einstein, et peu à peu toute la peinture, entre pleins d’autres...
Vous avez d’abord été professeur. Il a fallu du temps pour « oser » créer ou montrer ?
C’est vrai, à 23 ans, j’ai passé le concours de prof des beaux arts, que j’ai eu, mais je n’ai jamais eu de problèmes à créer ou montrer : ce sont souvent les galeristes qui n’osent pas montrer...
Comment vous situez-vous dans le paysage artistique contemporain ?
Je n’ai sincèrement jamais réussi à me situer dans ce paysage. Je dois certainement en faire partie, mais à quel niveau ? Ce n’est pas à moi de le dire. Je ne travaille pas avec cette problématique, je fais de mon mieux.
La Galerie Seine 51 représente des « monstres » contemporains, et vos cotations 2007 à Drouot sont déjà le début du succès : comment expliquez-vous ce succès ?
J’ai de la chance ! J'ai de la chance d'avoir rencontré Sylvie Palous, la directrice de la galerie Seine 51 qui, quand elle a découvert la série des 102, a été interpellée et a décidé de l'exposer. C'était ma première exposition importante à Paris. Depuis, nous échangeons beaucoup. Il est clair qu'exposer avec ces "monstres" est fabuleux car ce sont tous des artistes que je respecte, Jeff Cowen en particulier... Sylvie est peu à peu rentrée dans ma logique, mon univers plastique. L'exposition actuelle a mûri depuis un moment: au début ce rapport systématique avec le texte était assez complexe à gérer sur une telle longueur de série. De fait, il a fallu choisir des éléments, d'où "short cuts". Sylvie Palous a sélectionné les œuvres pour articuler la scénographie. C'est la première exposition de la sorte de la série des 203, elle inaugure pour certains le jour 1 d'une exposition Essentialiste. Dans tous les cas, les rapports avec les galeristes sont déterminants, c'est eux qui soutiennent et affrontent directement les réactions. Ils sont un lien avec le monde dans les périodes de Création. La galerie Seine 51, avec Sylvie Palous et Julien Woirin, prend des risques en exposant ce nouveau travail, c'est courageux, car tous ne le feraient pas. Mais de toute façon, l'Art c'est un peu une histoire d'Amour intellectuel...
Une autre personne a été très importante dans mon parcours, voire décisive, c'est le galeriste Roger Castang, à Perpignan, de Castangalerie, qui a cru en mon travail aux débuts et m'a toujours soutenu. Sans lui je n'aurais pas pu continuer et approfondir mon travail de la sorte. Il fut et est encore un soutien intellectuel dans mes prises de décisions. Il m'a tendu la main dont j'avais besoin pour avancer et continue encore à me soutenir. Aujourd'hui, c'est un ami.


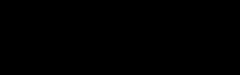























































 Comment êtes-vous arrivée sur le projet ?
Comment êtes-vous arrivée sur le projet ? Que pensez-vous de la structure du scénario en «pile ou face» ?
Que pensez-vous de la structure du scénario en «pile ou face» ? Comment avez-vous abordé le personnage de la «working girl» ?
Comment avez-vous abordé le personnage de la «working girl» ? Depuis quelque temps j’ai une avocate et je découvre ce monde-là. C’est un univers très dur. J’ai l’impression que c’est «oeil pour oeil, dent pour dent». Les hommes doivent être super forts et les femmes doivent être des hommes mais attention, des hommes sexy, perchés sur des talons !! Mon avocate est toujours habillée en petite robe, talons hauts, bien coiffée, très jolie. Vivre ça tous les jours, un cauchemar...
Depuis quelque temps j’ai une avocate et je découvre ce monde-là. C’est un univers très dur. J’ai l’impression que c’est «oeil pour oeil, dent pour dent». Les hommes doivent être super forts et les femmes doivent être des hommes mais attention, des hommes sexy, perchés sur des talons !! Mon avocate est toujours habillée en petite robe, talons hauts, bien coiffée, très jolie. Vivre ça tous les jours, un cauchemar... Et face à un monstre de comédie comme Thierry Lhermitte, c’était angoissant au début ?
Et face à un monstre de comédie comme Thierry Lhermitte, c’était angoissant au début ?




 L’intrigue du film se situe à Paris dans le milieu des affaires. Quel plaisir avez-vous pris à filmer toutes ces tours de verre, ces décors gris-bleu froids, ces transparences entre les bureaux qui rythment la vie des personnages ?
L’intrigue du film se situe à Paris dans le milieu des affaires. Quel plaisir avez-vous pris à filmer toutes ces tours de verre, ces décors gris-bleu froids, ces transparences entre les bureaux qui rythment la vie des personnages ? C’était surtout compliqué pour la lumière et Myriam Vinocour, ma chef opératrice, a été constamment confrontée au problème des reflets dans les vitres. En rencontrant des avocats dans leur cabinet, j’ai été frappée par une chose : c’est un monde en mouvement. Quand ils ne sont pas à leur bureau, ils bougent énormément avec les bras chargés de dossiers. Un décor transparent me permettait ce mouvement. Dans un lieu fermé sans baies vitrées, j’aurais filmé des gens assis derrière leur bureau. Je voulais lutter contre ce côté statique.
C’était surtout compliqué pour la lumière et Myriam Vinocour, ma chef opératrice, a été constamment confrontée au problème des reflets dans les vitres. En rencontrant des avocats dans leur cabinet, j’ai été frappée par une chose : c’est un monde en mouvement. Quand ils ne sont pas à leur bureau, ils bougent énormément avec les bras chargés de dossiers. Un décor transparent me permettait ce mouvement. Dans un lieu fermé sans baies vitrées, j’aurais filmé des gens assis derrière leur bureau. Je voulais lutter contre ce côté statique.


 Comment avez-vous choisi Alice Taglioni et Jocelyn Quivrin ?
Comment avez-vous choisi Alice Taglioni et Jocelyn Quivrin ? Lors d’un dîner j’ai parlé du film à un ami. Il m’a dit : « ton personnage, c’est Thierry Lhermitte ». Ça m’a paru évident. Il fallait quelqu’un qui, physiquement, soit en rapport avec ce souci esthétique de la science-fiction et qui soit terriblement sympathique. Thierry est très beau et très charismatique. Le personnage qu’il joue, c’est plus Figaro que Satan. Il est pris dans l’engrenage. Il tombe amoureux d’Alice. On ne peut pas le lui reprocher !
Lors d’un dîner j’ai parlé du film à un ami. Il m’a dit : « ton personnage, c’est Thierry Lhermitte ». Ça m’a paru évident. Il fallait quelqu’un qui, physiquement, soit en rapport avec ce souci esthétique de la science-fiction et qui soit terriblement sympathique. Thierry est très beau et très charismatique. Le personnage qu’il joue, c’est plus Figaro que Satan. Il est pris dans l’engrenage. Il tombe amoureux d’Alice. On ne peut pas le lui reprocher !




